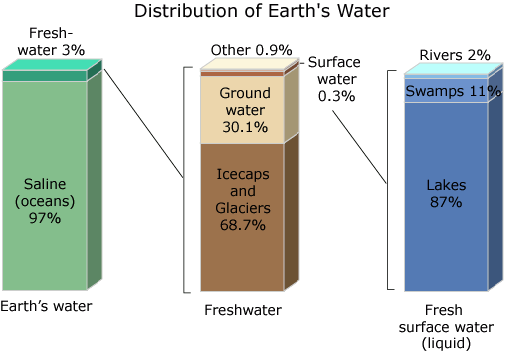Par Ulrich Beck, sociologue et philosophe. Traduit de l’allemand par Valérie Bonfils (LE MONDE, 27/12/11):
L’Europe a déjà accompli une fois un miracle : celui d’avoir transformé des ennemis en voisins. Face à la crise de l’euro, la question cardinale se pose aujourd’hui différemment : comment l’Europe peut-elle, dans l’avalanche de risques d’un monde globalisé, garantir paix, liberté et sécurité à ses citoyens ? Pour cela, il ne faut rien moins qu’un second miracle : passer de l’Europe de la bureaucratie à une Europe des citoyens.
Il fut un temps où, après la restructuration de la dette grecque, chacun poussa un soupir de soulagement et se prit à espérer : l’Europe est vivante et peut-être même suffisamment forte et habile pour surmonter ses problèmes. Puis le premier ministre grec Georges Papandréou annonça qu’il voulait consulter son peuple sur une question qui engageait son destin. C’est alors qu’apparut une réalité cachée, l’envers du décor : celui qui, dans cette Europe si fière de sa démocratie, veut la pratiquer, devient une menace pour l’Europe ! Papandréou se vit contraint de renoncer à la démocratie.
Nous avions espéré avec Hölderlin que là “où est le péril, croît le salutaire aussi”. Force est de constater qu’une tout autre réalité se profile : là où est le salutaire, croît le risque aussi. En tout cas, une question angoissante vient se nicher furtivement : ce qui est censé sauver l’euro va-t-il abolir l’Europe démocratique ? L’Union européenne “sauvée” ne sera-t-elle plus l’Union européenne telle que nous la connaissons, mais un Empire européen dominé par l’Allemagne ? Cette crise sans fin va-t-elle accoucher d’un monstre politique ?
Il n’y a pas si longtemps, il était encore fréquent de médire de la cacophonie de l’Union européenne. Subitement, l’Europe a un numéro de téléphone. Il se trouve à Berlin. Angela Merkel en est l’actuelle propriétaire.
Hier, il semblait que la crise soulevait la vieille question de la finalité de l’Union européenne. L’Europe doit-elle devenir une grande nation, une confédération d’Etats, un Etat fédéral, une simple communauté économique, des Nations unies indépendantes, voire quelque chose d’historiquement nouveau, à savoir une Europe cosmopolitique, fondée sur un droit européen, et qui coordonne politiquement des Etats nationaux européanisés ? Tout cela ressemble soudain à un folklore issu de temps révolus.
“Quelle Europe voulons-nous ?” Cette question donne faussement à penser qu’après le sauvetage de l’euro, on pourrait encore avoir le choix. Il semble qu’il soit trop tard, au moins pour les Grecs, les Italiens et les Espagnols. Le gouvernement grec, celui qui doit exiger le plus de ses citoyens, est de fait placé sous tutelle et se trouve dos au mur face aux troubles que connaît le pays. On fait appel à des professionnels de la liquidation, comme Mario Monti ou Lucas Papadémos. Car les plans d’économies se sont révélés suicidaires pour les dirigeants des Etats endettés qui ont dû céder leur place. Ce fut tout d’abord le cas en Irlande et au Portugal, puis en Grèce, en Italie et en Espagne.
Ce n’est pas seulement la structure du pouvoir qui a durablement changé, mais c’est une nouvelle logique de pouvoir qui émerge. Voici à quoi ressemble la nouvelle “Europe de Merkel”(Der Spiegel du 31 octobre) : le pouvoir obéit à une logique d’empire, non pas militaire mais économique, qui établit une différence entre pays débiteurs et pays créanciers (c’est pourquoi, il est absurde de parler de “IVe R eich”). Son fondement idéologique est ce que j’aimerais appeler l’euronationalisme allemand, soit une version européenne du nationalisme du deutschemark.
C’est ainsi que la culture allemande de la stabilité est élevée au rang d’idée européenne dominante. La stabilisation du pouvoir hégémonique repose sur l’assentiment des pays européens indépendants. Comme Adenauer en son temps, certains croient que le modèle allemand exerce une force d’attraction magnétique sur les Européens. Il est plus réaliste de se demander sur quoi repose le pouvoir de sanction. Angela Merkel a décrété qu’une perte de souveraineté était le prix à payer pour un endettement démesuré.
Les pays qui n’ont pas adopté l’euro se sentent exclus des processus de décision qui déterminent le présent et l’avenir de l’Europe. Ils se voient rabaissés au rang de simples observateurs et n’ont plus voix au chapitre politique. La Grande-Bretagne, qui est entraînée vers une position insignifiante en Europe, en est l’exemple le plus évident.
Pourtant au sein des pays de la zone euro, le nouveau centre de pouvoir, secoué par la crise, connaît également une division dramatique, cette fois entre les pays qui sont ou seront bientôt sous perfusion du fonds de sauvetage et ceux qui financent celui-ci. Les premiers n’ont plus d’autre issue que de se plier aux exigences de l’euronationalisme allemand. Ainsi, l’Italie, sans doute l’un des pays les plus européens, est-elle menacée de ne plus jouer aucun rôle dans les choix décisifs de l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
Le multilatéralisme devient ainsi unilatéralisme, l’égalité hégémonie, la souveraineté retrait de souveraineté, la reconnaissance de la dignité démocratique d’autres nations dépossession de cette reconnaissance. Même la France, qui a longtemps dominé l’Union européenne, doit à présent suivre les préconisations de Berlin parce qu’elle craint aussi pour son triple A.
Cet avenir, qui germe dans le laboratoire du sauvetage de l’euro, dont il est pour ainsi dire un effet secondaire intentionnel, ressemble effectivement, j’ose à peine le dire, à une variante européenne tardive de l’Union soviétique. L’économie planifiée centralisée ne consiste plus ici à élaborer des plans quinquennaux pour produire des biens et des services mais pour réduire la dette. Leur application est confiée à des “commissaires” qui, sur la base de “mécanismes de sanction” (Angela Merkel), sont habilités à tout mettre en oeuvre pour détruire les villages Potemkine de pays notoirement endettés. On connaît le destin de l’Union soviétique.
Pourquoi avons-nous à présent une Europe allemande malgré les mises en garde insistantes de Thomas Mann dans le passé ? L’Allemagne ne peut pas être allemande sans l’Europe. Déjà la réunification des deux Allemagnes n’a été possible que grâce à la pacification de l’Europe. Dans la crise de l’euro, ce qui est “allemand” et ce qui est “européen” (ou doit le devenir) est de nouveau également tissé d’une manière nouvelle. L’Allemagne est trop souveraine, trop puissante, trop européenne et impliquée dans l’économie mondiale pour pouvoir s’offrir le luxe de ne pas sauver l’euro. Un éléphant ne gagne pas la confiance en se faisant passer pour un pauvre moineau. Le chemin vers l’empire européen est donc de nouveau pavé de bonnes intentions européennes. Comme toujours, le mot “pouvoir”, tabou en Allemagne, est remplacé délibérément par “responsabilité”, le mot préféré des Allemands.
Angela Merkel décline la “responsabilité européenne” selon les maximes du pouvoir de l’euronationalisme allemand. Il s’agit donc de chercher des réponses allemandes à la crise européenne, et même, en fin de compte, de faire de la culture de la stabilité allemande la réponse passe-partout cette crise. Il en résulte un mélange d’engagement européen réel et de nationalisme authentique, d’engagement européen plus ou moins feint vis-à-vis de l’étranger mais aussi de nationalisme plus ou moins feint face au scepticisme croissant des Allemands à l’égard de l’Europe. Le pouvoir tente ainsi, de manière pragmatique, de concilier l’inconciliable, c’est-à-dire, dans un climat anti-européen en Allemagne, de sauver l’euro et l’Union européenne et de remporter des élections.
La chancelière procède à un partage national des valeurs européennes. A l’intérieur : la démocratie ; à l’extérieur : losers can’t be choosers (“Les perdants ne peuvent pas être ceux qui choisissent”). La formule magique de l’Allemagne d’après-guerre, la “politique de stabilité”, implique, pour les autres, de renoncer à nouveau à la liberté politique.
Dans un mélange, digne d’Angela Merkel, d’assez grande confusion, d’hypocrisie, de rigueur protestante et de calcul européen, le gouvernement Merkel, y compris l’Européen Schäuble, érige l’euronationalisme allemand en ligne directrice d’interventions politico-économiques dans les pays de la zone euro qui ont péché. Il ne s’agit rien moins que de civiliser un Sud trop dépensier, au nom de la “raison économique”, de “l’Europe” et de “l’économie mondiale”. Notre politique financière est d’autant plus allemande qu’elle est européenne : telle est la devise.
Toutefois, cette structure hégémonique ne pourrait-elle pas receler la possibilité de lever les blocages de l’Union européenne ? Je dis bien “pourrait”. En effet, comment gouverner cet énorme espace de 27 Etats membres s’il faut, avant chaque décision, convaincre 27 chefs de gouvernement, conseils des ministres et Parlements ? La réponse est contenue dans la question. Contrairement à l’Union européenne, l’empire européen est de facto une communauté à deux vitesses. Seule la zone euro (et non l’Union européenne) jouera à l’avenir un rôle avant-gardiste dans l’intégration européenne. Ne serait-ce pas là une chance alors qu’il est urgent d’imaginer de nouvelles institutions ?
Il est question depuis assez longtemps déjà d’un “gouvernement économique”. Ce qui se cache derrière cette notion doit être précisé, négocié et expérimenté. A plus ou moins court terme, les euro-obligations, très controversées, seront vraisemblablement mises en place. Wolfgang Schäuble, le ministre des finances allemand, plaide d’ores et déjà pour l’introduction d’un impôt sur les transactions financières auquel, au sein de l’Union européenne, la Grande-Bretagne opposerait assurément son veto.
Cependant, cette voie vers une Europe des apparatchiks, avec un Politburo à Bruxelles ou à Berlin, parachève la malformation congénitale de l’Europe et pousse à l’extrême le paradoxe d’une Europe qui existe bel et bien sans Européens. Plus encore, les citoyens des pays financeurs se sentent dépouillés et ceux des pays débiteurs mis sous tutelle. L’Europe devient l’ennemi. Au lieu d’avoir une Europe des citoyens, on assiste à un mouvement de colère des citoyens à son égard.
Le président américain John F. Kennedy a autrefois étonné le monde entier en proposant la création des Peace Corps. Pourquoi la nouvelle Européenne qu’est Angela Merkel ne pourrait-elle pas à son tour étonner le monde en soutenant la mise en oeuvre de l’idée suivante : la crise de l’euro n’est pas seulement une question d’économie ; il s’agit aussi d’engager par le bas l’européanisation de l’Europe ; il s’agit de diversité et d’autodétermination, d’un espace politique et culturel dans lequel les citoyens ne peuvent plus continuer à se sentir ennemis avec, d’un côté, les mis sous tutelle et, de l’autre, les dépouillés. Créons l’Europe des citoyens, maintenant !
L’Europe a déjà accompli une fois un miracle : celui d’avoir transformé des ennemis en voisins. Face à la crise de l’euro, la question cardinale se pose aujourd’hui différemment : comment l’Europe peut-elle, dans l’avalanche de risques d’un monde globalisé, garantir paix, liberté et sécurité à ses citoyens ? Pour cela, il ne faut rien moins qu’un second miracle : passer de l’Europe de la bureaucratie à une Europe des citoyens.
Il fut un temps où, après la restructuration de la dette grecque, chacun poussa un soupir de soulagement et se prit à espérer : l’Europe est vivante et peut-être même suffisamment forte et habile pour surmonter ses problèmes. Puis le premier ministre grec Georges Papandréou annonça qu’il voulait consulter son peuple sur une question qui engageait son destin. C’est alors qu’apparut une réalité cachée, l’envers du décor : celui qui, dans cette Europe si fière de sa démocratie, veut la pratiquer, devient une menace pour l’Europe ! Papandréou se vit contraint de renoncer à la démocratie.
Nous avions espéré avec Hölderlin que là “où est le péril, croît le salutaire aussi”. Force est de constater qu’une tout autre réalité se profile : là où est le salutaire, croît le risque aussi. En tout cas, une question angoissante vient se nicher furtivement : ce qui est censé sauver l’euro va-t-il abolir l’Europe démocratique ? L’Union européenne “sauvée” ne sera-t-elle plus l’Union européenne telle que nous la connaissons, mais un Empire européen dominé par l’Allemagne ? Cette crise sans fin va-t-elle accoucher d’un monstre politique ?
Il n’y a pas si longtemps, il était encore fréquent de médire de la cacophonie de l’Union européenne. Subitement, l’Europe a un numéro de téléphone. Il se trouve à Berlin. Angela Merkel en est l’actuelle propriétaire.
Hier, il semblait que la crise soulevait la vieille question de la finalité de l’Union européenne. L’Europe doit-elle devenir une grande nation, une confédération d’Etats, un Etat fédéral, une simple communauté économique, des Nations unies indépendantes, voire quelque chose d’historiquement nouveau, à savoir une Europe cosmopolitique, fondée sur un droit européen, et qui coordonne politiquement des Etats nationaux européanisés ? Tout cela ressemble soudain à un folklore issu de temps révolus.
“Quelle Europe voulons-nous ?” Cette question donne faussement à penser qu’après le sauvetage de l’euro, on pourrait encore avoir le choix. Il semble qu’il soit trop tard, au moins pour les Grecs, les Italiens et les Espagnols. Le gouvernement grec, celui qui doit exiger le plus de ses citoyens, est de fait placé sous tutelle et se trouve dos au mur face aux troubles que connaît le pays. On fait appel à des professionnels de la liquidation, comme Mario Monti ou Lucas Papadémos. Car les plans d’économies se sont révélés suicidaires pour les dirigeants des Etats endettés qui ont dû céder leur place. Ce fut tout d’abord le cas en Irlande et au Portugal, puis en Grèce, en Italie et en Espagne.
Ce n’est pas seulement la structure du pouvoir qui a durablement changé, mais c’est une nouvelle logique de pouvoir qui émerge. Voici à quoi ressemble la nouvelle “Europe de Merkel”(Der Spiegel du 31 octobre) : le pouvoir obéit à une logique d’empire, non pas militaire mais économique, qui établit une différence entre pays débiteurs et pays créanciers (c’est pourquoi, il est absurde de parler de “IVe R eich”). Son fondement idéologique est ce que j’aimerais appeler l’euronationalisme allemand, soit une version européenne du nationalisme du deutschemark.
C’est ainsi que la culture allemande de la stabilité est élevée au rang d’idée européenne dominante. La stabilisation du pouvoir hégémonique repose sur l’assentiment des pays européens indépendants. Comme Adenauer en son temps, certains croient que le modèle allemand exerce une force d’attraction magnétique sur les Européens. Il est plus réaliste de se demander sur quoi repose le pouvoir de sanction. Angela Merkel a décrété qu’une perte de souveraineté était le prix à payer pour un endettement démesuré.
Les pays qui n’ont pas adopté l’euro se sentent exclus des processus de décision qui déterminent le présent et l’avenir de l’Europe. Ils se voient rabaissés au rang de simples observateurs et n’ont plus voix au chapitre politique. La Grande-Bretagne, qui est entraînée vers une position insignifiante en Europe, en est l’exemple le plus évident.
Pourtant au sein des pays de la zone euro, le nouveau centre de pouvoir, secoué par la crise, connaît également une division dramatique, cette fois entre les pays qui sont ou seront bientôt sous perfusion du fonds de sauvetage et ceux qui financent celui-ci. Les premiers n’ont plus d’autre issue que de se plier aux exigences de l’euronationalisme allemand. Ainsi, l’Italie, sans doute l’un des pays les plus européens, est-elle menacée de ne plus jouer aucun rôle dans les choix décisifs de l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
Le multilatéralisme devient ainsi unilatéralisme, l’égalité hégémonie, la souveraineté retrait de souveraineté, la reconnaissance de la dignité démocratique d’autres nations dépossession de cette reconnaissance. Même la France, qui a longtemps dominé l’Union européenne, doit à présent suivre les préconisations de Berlin parce qu’elle craint aussi pour son triple A.
Cet avenir, qui germe dans le laboratoire du sauvetage de l’euro, dont il est pour ainsi dire un effet secondaire intentionnel, ressemble effectivement, j’ose à peine le dire, à une variante européenne tardive de l’Union soviétique. L’économie planifiée centralisée ne consiste plus ici à élaborer des plans quinquennaux pour produire des biens et des services mais pour réduire la dette. Leur application est confiée à des “commissaires” qui, sur la base de “mécanismes de sanction” (Angela Merkel), sont habilités à tout mettre en oeuvre pour détruire les villages Potemkine de pays notoirement endettés. On connaît le destin de l’Union soviétique.
Pourquoi avons-nous à présent une Europe allemande malgré les mises en garde insistantes de Thomas Mann dans le passé ? L’Allemagne ne peut pas être allemande sans l’Europe. Déjà la réunification des deux Allemagnes n’a été possible que grâce à la pacification de l’Europe. Dans la crise de l’euro, ce qui est “allemand” et ce qui est “européen” (ou doit le devenir) est de nouveau également tissé d’une manière nouvelle. L’Allemagne est trop souveraine, trop puissante, trop européenne et impliquée dans l’économie mondiale pour pouvoir s’offrir le luxe de ne pas sauver l’euro. Un éléphant ne gagne pas la confiance en se faisant passer pour un pauvre moineau. Le chemin vers l’empire européen est donc de nouveau pavé de bonnes intentions européennes. Comme toujours, le mot “pouvoir”, tabou en Allemagne, est remplacé délibérément par “responsabilité”, le mot préféré des Allemands.
Angela Merkel décline la “responsabilité européenne” selon les maximes du pouvoir de l’euronationalisme allemand. Il s’agit donc de chercher des réponses allemandes à la crise européenne, et même, en fin de compte, de faire de la culture de la stabilité allemande la réponse passe-partout cette crise. Il en résulte un mélange d’engagement européen réel et de nationalisme authentique, d’engagement européen plus ou moins feint vis-à-vis de l’étranger mais aussi de nationalisme plus ou moins feint face au scepticisme croissant des Allemands à l’égard de l’Europe. Le pouvoir tente ainsi, de manière pragmatique, de concilier l’inconciliable, c’est-à-dire, dans un climat anti-européen en Allemagne, de sauver l’euro et l’Union européenne et de remporter des élections.
La chancelière procède à un partage national des valeurs européennes. A l’intérieur : la démocratie ; à l’extérieur : losers can’t be choosers (“Les perdants ne peuvent pas être ceux qui choisissent”). La formule magique de l’Allemagne d’après-guerre, la “politique de stabilité”, implique, pour les autres, de renoncer à nouveau à la liberté politique.
Dans un mélange, digne d’Angela Merkel, d’assez grande confusion, d’hypocrisie, de rigueur protestante et de calcul européen, le gouvernement Merkel, y compris l’Européen Schäuble, érige l’euronationalisme allemand en ligne directrice d’interventions politico-économiques dans les pays de la zone euro qui ont péché. Il ne s’agit rien moins que de civiliser un Sud trop dépensier, au nom de la “raison économique”, de “l’Europe” et de “l’économie mondiale”. Notre politique financière est d’autant plus allemande qu’elle est européenne : telle est la devise.
Toutefois, cette structure hégémonique ne pourrait-elle pas receler la possibilité de lever les blocages de l’Union européenne ? Je dis bien “pourrait”. En effet, comment gouverner cet énorme espace de 27 Etats membres s’il faut, avant chaque décision, convaincre 27 chefs de gouvernement, conseils des ministres et Parlements ? La réponse est contenue dans la question. Contrairement à l’Union européenne, l’empire européen est de facto une communauté à deux vitesses. Seule la zone euro (et non l’Union européenne) jouera à l’avenir un rôle avant-gardiste dans l’intégration européenne. Ne serait-ce pas là une chance alors qu’il est urgent d’imaginer de nouvelles institutions ?
Il est question depuis assez longtemps déjà d’un “gouvernement économique”. Ce qui se cache derrière cette notion doit être précisé, négocié et expérimenté. A plus ou moins court terme, les euro-obligations, très controversées, seront vraisemblablement mises en place. Wolfgang Schäuble, le ministre des finances allemand, plaide d’ores et déjà pour l’introduction d’un impôt sur les transactions financières auquel, au sein de l’Union européenne, la Grande-Bretagne opposerait assurément son veto.
Cependant, cette voie vers une Europe des apparatchiks, avec un Politburo à Bruxelles ou à Berlin, parachève la malformation congénitale de l’Europe et pousse à l’extrême le paradoxe d’une Europe qui existe bel et bien sans Européens. Plus encore, les citoyens des pays financeurs se sentent dépouillés et ceux des pays débiteurs mis sous tutelle. L’Europe devient l’ennemi. Au lieu d’avoir une Europe des citoyens, on assiste à un mouvement de colère des citoyens à son égard.
Le président américain John F. Kennedy a autrefois étonné le monde entier en proposant la création des Peace Corps. Pourquoi la nouvelle Européenne qu’est Angela Merkel ne pourrait-elle pas à son tour étonner le monde en soutenant la mise en oeuvre de l’idée suivante : la crise de l’euro n’est pas seulement une question d’économie ; il s’agit aussi d’engager par le bas l’européanisation de l’Europe ; il s’agit de diversité et d’autodétermination, d’un espace politique et culturel dans lequel les citoyens ne peuvent plus continuer à se sentir ennemis avec, d’un côté, les mis sous tutelle et, de l’autre, les dépouillés. Créons l’Europe des citoyens, maintenant !